« SOUMISSION VOLONTAIRE : DÉCRYPTAGE DES MÉCANISMES PSYCHOLOGIQUES QUI NOUS POUSSENT À OBÉIR
Et si notre soumission la plus frappante était celle que nous acceptons librement ?
La soumission volontaire est un paradoxe qui intrigue philosophes et psychologues depuis des décennies. Nous la croisons dans notre quotidien : dans notre rapport à l’autorité au travail, dans notre adhésion à des normes sociales ou dans notre fascination pour des figures charismatiques. Loin d’être un simple acte de faiblesse, il s’agit d’un processus psychologique complexe, profondément enraciné dans notre besoin d’appartenance et de sécurité. C’est ce qu’a notamment mis en lumière le sociologue Max Weber dans ses travaux.
Cet article plonge au cœur des rouages de l’obéissance pour comprendre pourquoi, parfois, nous cédons volontairement notre libre arbitre.
Au-delà du mythe : les fondements de la soumission volontaire
La soumission volontaire ne naît pas toujours de la contrainte physique. Elle est souvent le fruit d’une construction psychique et sociale. Ce comportement puise ses sources dans des terreaux profonds comme la peur et l’anxiété. Un sentiment d’insécurité latent, qu’il soit social (perte d’emploi, précarité) ou personnel, nous rend plus vulnérables et en quête de protection, favorisant ainsi la soumission à un ordre perçu comme rassurant et stable.
Par ailleurs, le besoin d’autorité est souvent analysé comme la recherche d’une figure protectrice, remplissant un rôle archaïque. Le psychologue Gérard Mendel, dans son ouvrage « Une histoire de l’autorité », défend la thèse selon laquelle l’autorité, liée à l’image paternelle, serait une réponse au sentiment d’abandon issu de la séparation précoce d’avec la mère. Cette dynamique psychique nous prédispose alors à chercher des figures fortes auxquelles nous soumettre pour retrouver un sentiment de sécurité.
L’expérience fondatrice de Stanley Milgram et l’entrée dans l’« état agentique »
Aucune discussion sur la soumission à l’autorité ne saurait être complète sans évoquer les travaux du psychologue social Stanley Milgram. Dans ses célèbres expériences menées dans les années 1960, il a démontré de façon saisissante à quel point des individus ordinaires étaient capables d’infliger des souffrances à autrui sur ordre d’une figure d’autorité perçue comme légitime.
Le mécanisme clé qu’il a mis en lumière est le passage de l’état autonome à l’état agentique. Milgram explique que pour fonctionner en société, les individus acceptent de renoncer à une part de leur autonomie au profit d’une structure hiérarchique. Dans cet « état agentique », la personne se perçoit comme un simple exécutant au service de l’autorité. Sa moralité personnelle s’efface alors au profit d’un sentiment de devoir envers celle qui commande. Comme le décrit l’analyse de son travail, l’individu opère une « démission de la conscience morale » et devient capable de poser des actes qu’il n’aurait jamais commis de sa propre initiative.
Dans les conditions les plus fortes de son expérience, près de 65% des participants sont allés jusqu’à infliger ce qu’ils croyaient être des décharges électriques potentiellement mortelles, simplement parce qu’un expérimentateur en blouse blanche les y encourageait.
Les visages multiples de la soumission
La soumission volontaire peut prendre plusieurs formes qui éclairent la complexité du phénomène :
· La soumission consciente : Un acte délibéré où l’individu, en pleine connaissance de cause, renonce à son pouvoir pour se conformer à une attente ou une norme sociale.
· La soumission inconsciente : Probablement la plus insidieuse, elle découle d’un conditionnement antérieur ou de traumatismes non résolus. La personne n’a même pas conscience qu’elle adopte une posture de subordination. Ce type de soumission remonte le plus souvent à la petite enfance et s’appuie sur des mécanismes de culpabilité et d’autosabotage.
· La pseudo-soumission : Une forme de résistance passive-agressive où l’individu semble obéir tout en sabotant discrètement les directives de la figure d’autorité.
Du laboratoire à la vie réelle : où se niche la soumission volontaire ?
Ces mécanismes ne sont pas que des curiosités de laboratoire. Ils opèrent dans notre vie de tous les jours :
· Dans l’entreprise : Les modèles de management modernes, comme le décrit le psychiatre Christophe Dejours, peuvent encourager une forme d’« auto-autorité » où le salarié est incité à intérioriser lui-même les contraintes et les objectifs de l’entreprise. La menace de licenciement, vécue comme une « mort sociale », réactive des angoisses archaïques qui renforcent la soumission.(cf « souffrance au travail »)
· Dans les relations interpersonnelles : La soumission peut s’installer dans des relations déséquilibrées, que ce soit dans la sphère privée (abus domestique) ou professionnelle (harcèlement moral).
· Dans l’adhésion aux médias et aux leaders : La légitimité « charismatique » décrite par le sociologue Max Weber, où la soumission est basée sur les qualités extraordinaires attribuées à un leader, est un terreau fertile pour la soumission volontaire.
Comment développer un rapport plus conscient à l’autorité ?
Prendre conscience de ces mécanismes est la première étape pour retrouver son autonomie. Plusieurs stratégies peuvent être mises en place :
· Renforcer l’auto-assertivité : Apprendre à exprimer ses besoins, ses opinions et ses limites de façon claire et respectueuse, sans crainte du conflit.
· Développer sa pensée critique : Apprendre à remettre en question les informations et les ordres, à analyser le bien-fondé d’une demande et à considérer les alternatives.
· Rechercher un soutien : Que ce soit par le coaching, qui peut aider à identifier les comportements de soumission et à développer des outils pratiques, ou par une approche thérapeutique pour travailler sur l’estime de soi et les conditionnements profonds.
Entre nécessité sociale et aliénation personnelle
La soumission volontaire est une facette incontournable de la vie en société. Elle permet la coopération et l’ordre, mais devient problématique lorsqu’elle nous amène à renier notre intégrité, notre raison et nos valeurs. Des travaux de Stanley Milgram sur l’obéissance à l’autorité aux analyses plus contemporaines sur le management, la psychologie nous offre des clés précieuses pour comprendre ce qui nous pousse à obéir. En comprenant ces mécanismes – qu’ils soient conscients, inconscients ou le fruit d’un état agentique – nous pouvons cultiver un rapport plus lucide et plus libre à l’autorité, apprenant à discerner quand la soumission est une adaptation sociale « nécessaire » et quand elle devient une aliénation volontaire.
Prendre rendez-vous
Addresse
807 chemin de Campredon
30260 QUISSAC
Téléphone
+0695173834
instant.present@gmx.fr
Horaires
9h-12h / 14h-19h
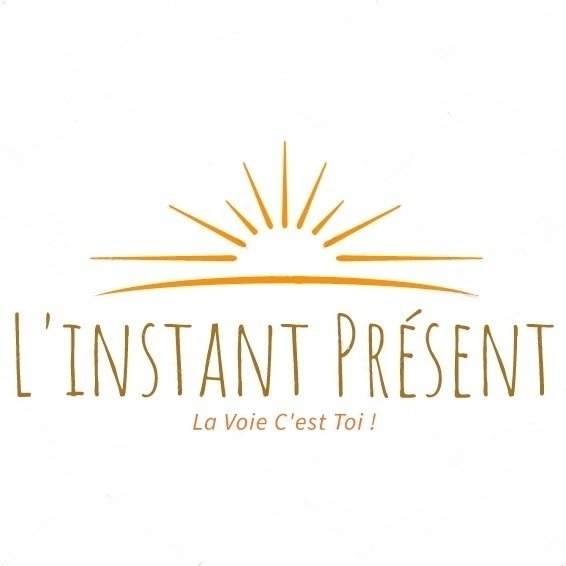
Commentaires récents